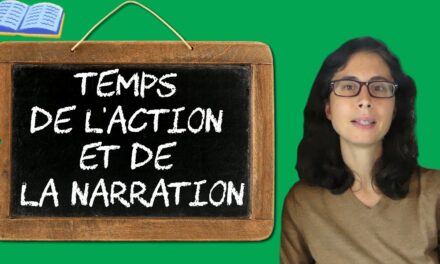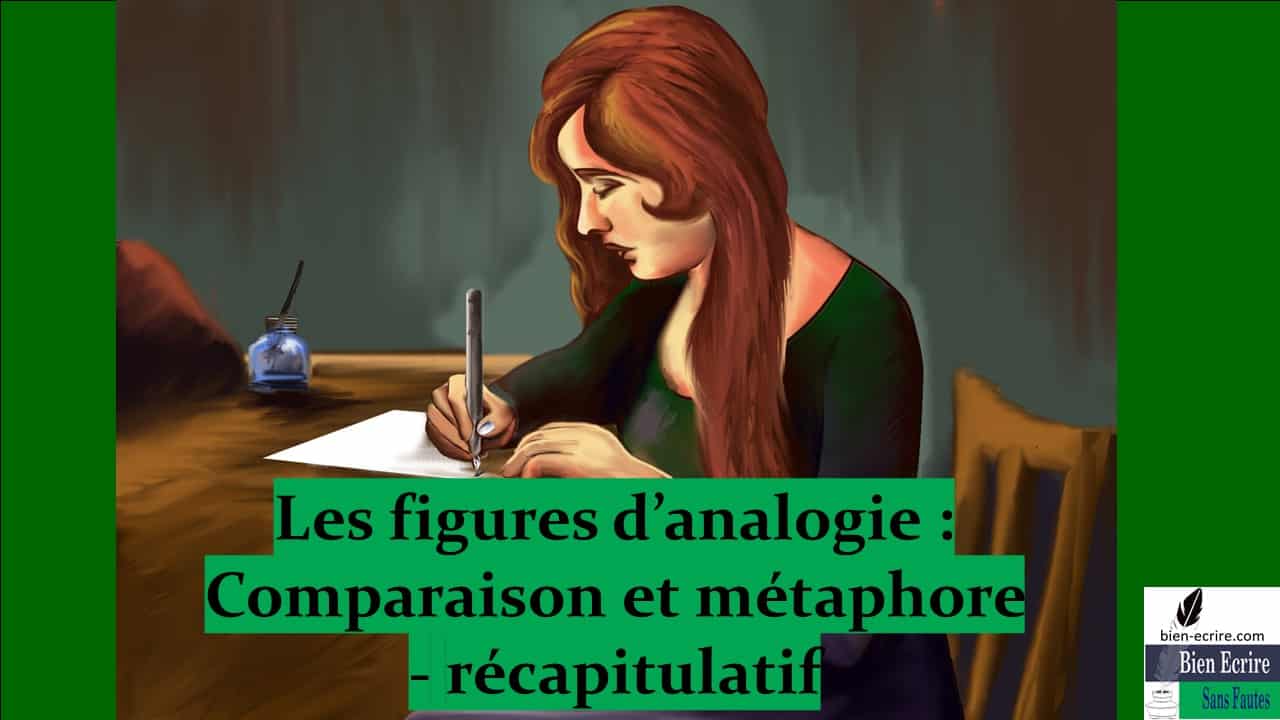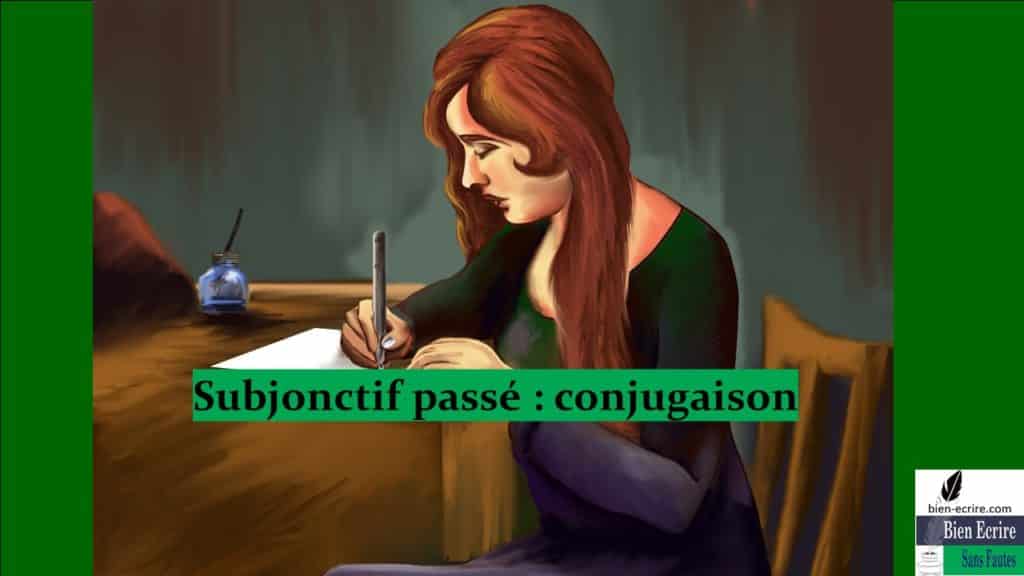Objectif
Vous saurez reconnaître, construire et accorder correctement les subordonnées complétives, c’est-à-dire les propositions introduites le plus souvent par que (mais aussi si, ce que / ce qui / ce dont, à ce que, de ce que) qui complètent un verbe, un adjectif ou un nom. L’accent est mis sur les fonctions (COD, sujet, attribut, complément du nom ou de l’adjectif), le choix du mode (indicatif / subjonctif / conditionnel) et les tours à risque.
L’essentiel à retenir
- Une complétive remplit une fonction syntaxique attendue par un mot recteur (verbe, adjectif, nom) et forme un bloc que l’on peut souvent remplacer par cela.
Ex. : Je pense que c’est utile → Je pense cela. - Les introducteurs les plus fréquents sont que (déclaration, opinion), si (totale de type oui/non au style indirect), ce que / ce qui / ce dont (pronom neutre + que), et des tours régis comme à ce que, de ce que.
- Mode :
- Indicatif après constatation, certitude, déclaration affirmatives.
- Subjonctif après volonté, nécessité, sentiment, doute, appréciation, ou après certaines locutions.
- Conditionnel pour le futur dans le passé au style indirect ou la réserve (information rapportée).
- Jamais d’inversion ni est-ce que dans une complétive. La subordonnée adopte l’ordre Sujet + Verbe.
1) Qu’est-ce qu’une complétive ?
Une proposition subordonnée qui complète un élément recteur. Elle peut être :
1.1 COD d’un verbe de parole, pensée, perception intellectuelle
- Verbes de déclaration/constatation : dire, affirmer, déclarer, constater, remarquer, admettre…
Ex. : Il affirme que la séance commence à 14 h. - Verbes d’opinion : penser, croire, estimer, juger, trouver…
Ex. : Je trouve que ce plan est clair. - Verbes de connaissance : savoir, ignorer, apprendre…
Ex. : Nous savons qu’il part.
1.2 Sujet réel (avec il explétif)
- Schéma fréquent : Il est + adj./nom + que…
Ex. : Il est probable qu’il viendra ; Il est nécessaire qu’elle réponde.
Test : remplacez par Le fait que… → Le fait qu’il viendra est probable.
1.3 Attribut du sujet / de l’objet
- Plus rare, mais possible dans des tours figés.
Ex. : La certitude qu’il reviendra est rassurante (apposition nominale proche de l’attribut).
1.4 Complément de l’adjectif
- Après des adjectifs de sentiment/jugement : content, surpris, désolé, fier, heureux, possible, nécessaire…
Ex. : Je suis heureux qu’elle accepte.
1.5 Complément du nom
- Après des noms d’idée/discours : idée, fait, nouvelle, espoir, rumeur, décision…
Ex. : La nouvelle qu’il déménage nous attriste.
2) Choisir le bon introducteur
2.1 que déclaratif
- Le plus courant, neutre.
Ex. : Il dit que tout est prêt.
2.2 si pour une totale au style indirect
- Transforme une question oui/non en complétive.
Ex. direct : « Viens-tu ? » → indirect : Il demande si je viens.
Attention : pas d’« est-ce que » dans la subordonnée.
2.3 ce que / ce qui / ce dont (pronom neutre + que)
- Quand le contenu de la question ou de la pensée porte sur un élément inconnu.
- ce que = COD ; Je ne vois pas ce que vous voulez.
- ce qui = sujet ; Expliquez-nous ce qui se passe.
- ce dont = complément régi par de ; Il ignore ce dont ils parlent.
2.4 Tours régis : à ce que, de ce que
- Réquèrent certains verbes ou locutions :
- veiller à ce que, tenir à ce que, s’attendre à ce que, s’opposer à ce que, consentir à ce que → subjonctif.
Ex. : Elle veille à ce que tout soit conforme. - se réjouir de ce que, se plaindre de ce que, avoir honte de ce que → mode variable selon le sens et la chronologie, souvent subjonctif si l’on exprime le souhait / l’éventualité.
Ex. : Ils se réjouissent de ce que vous ayez obtenu le poste.
- veiller à ce que, tenir à ce que, s’attendre à ce que, s’opposer à ce que, consentir à ce que → subjonctif.
Astuce sûre : mémorisez les verbes fréquents + à ce que et + de ce que. Ils appellent quasi toujours le subjonctif si le contenu n’est pas tenu pour certain au moment où l’on parle.
3) Quel mode dans la complétive ?
3.1 Indicatif si le fait est tenu pour réel / constaté
- Après verbes de constatation/certitude affirmés : savoir, constater, remarquer, être sûr/certain, il est clair/évident…
Ex. : Je sais qu’il vient.
Négations et interrogations de ces verbes peuvent entraîner le subjonctif selon le sens : Je ne crois pas qu’il vienne (doute).
3.2 Subjonctif si l’on exprime volonté, nécessité, jugement, émotion, doute
- Verbes : vouloir, souhaiter, exiger, refuser, douter, craindre, regretter…
Ex. : Je veux qu’il réponde ; Je doute qu’il vienne. - Tournures impersonnelles : Il est nécessaire / possible / important que… → subjonctif.
3.3 Conditionnel pour la mise à distance ou le futur dans le passé
- Information rapportée / non confirmée : Il dirait qu’il part demain.
- Style indirect au passé : Il a promis qu’il viendrait (futur du direct → conditionnel).
Rappels utiles :
- Espérer que prend généralement l’indicatif (souvent futur) : J’espère qu’il viendra.
- Après avant que, c’est une conjonctive de temps, pas une complétive ; subjonctif requis.
4) Ponctuation, place, style
- Pas de virgule obligatoire entre principale et complétive introduite par que lorsque la phrase est simple. On met une virgule si la complétive est longue, incise, ou réclame une respiration.
- En tête de phrase, la complétive peut être thématisée : Que vous réussissiez m’importe avant tout. (registre soutenu).
- Évitez les doublons : Il dit que comme quoi… → préférez Il dit que… ou Il prétend que…
5) Tours fautifs et points de vigilance
- Interdits en complétive : inversion et est-ce que → Je me demande si…, jamais Je me demande est-ce que.
- Concordance : au style indirect passé, le futur du discours direct devient conditionnel ; demain → le lendemain.
- Ambiguïtés de mode après penser / croire / trouver : à l’affirmatif, plutôt indicatif ; à la négation ou interrogation, le subjonctif devient fréquent selon l’intention de doute.
- À ce que / de ce que : ne les remplacez pas par que sans vérifier la régence du verbe. Veiller à ce que ≠ Veiller que.
6) Tests pratiques d’analyse
- Test « cela » : si la subordonnée remplace cela, elle est souvent COD de la principale.
- Test « le fait que » : si l’encadrement par Le fait que… fonctionne en sujet, la complétive joue le rôle de sujet réel.
- Test du mode : le contenu est-il tenu pour vrai par l’énonciateur (→ indicatif) ou souhaité, craint, mis en doute (→ subjonctif) ?
Mini-FAQ
Complétive et interrogative indirecte, est-ce la même chose ?
L’interrogative indirecte est un type de complétive. Elle rapporte une question et s’introduit par si (totale) ou un mot interrogatif (partielle), sans inversion ni est-ce que.
Quand choisir « ce que / ce qui / ce dont » ?
- ce que si la subordonnée remplit la fonction COD ;
- ce qui si elle remplit la fonction sujet ;
- ce dont si le verbe ou l’adjectif demande la préposition de.
Indicatif ou subjonctif après « penser que » ?
À l’affirmatif, indicatif par défaut (Je pense qu’il vient). À la négation ou en interrogation, subjonctif fréquent si l’on marque un doute (Pensez-vous qu’il vienne ?).
Faut-il une virgule avant « que » ?
Non en règle générale. On en met une si la phrase est longue ou si l’on intercale une incise.
« Veiller à ce que » et « s’attendre à ce que » exigent quel mode ?
Le subjonctif : Elle veille à ce que tout soit conforme ; Il s’attend à ce que vous répondiez.