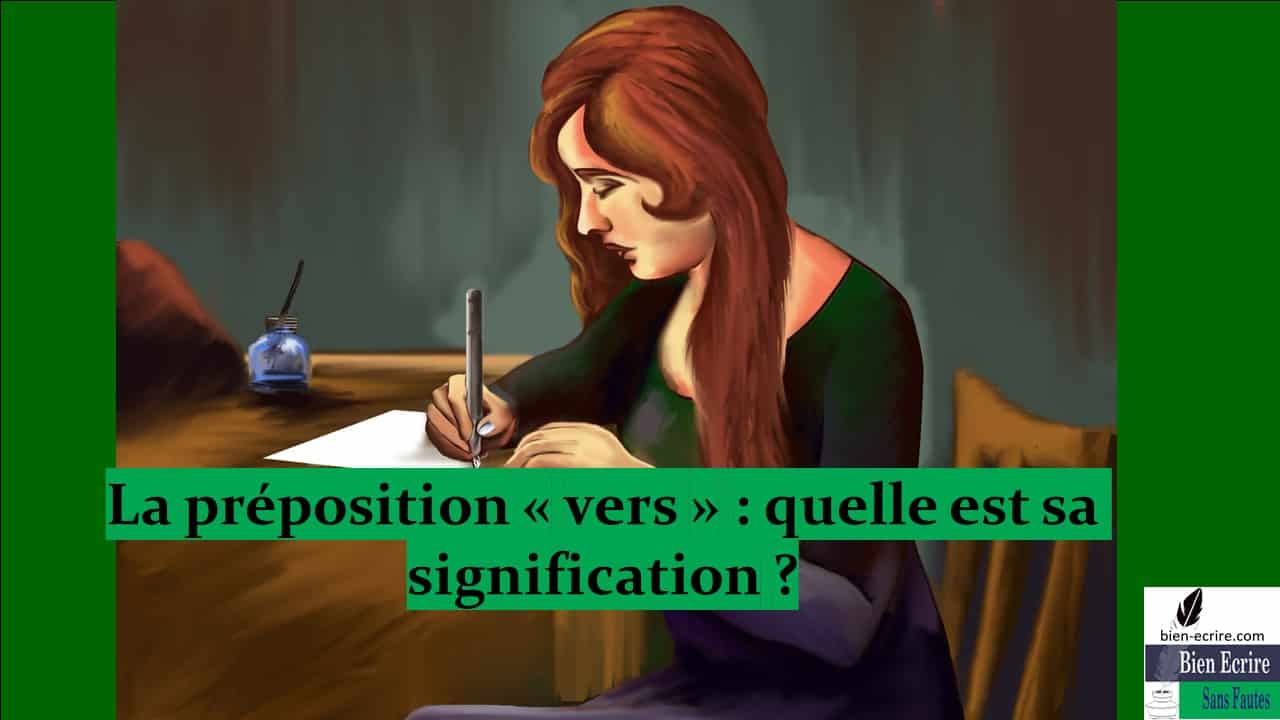Public collège/lycée/FLE • Objectif : varier les liaisons, préciser le raisonnement, éviter l’effet « liste ». Tu repars avec un inventaire classé par nuance, l’indication courant/soutenu, des exemples modèles, des paires à ne pas confondre, un mémo dosage, des exercices.
Typo rappel : en français, une espace avant : ; ! ?. Les connecteurs se virgulent quand ils ouvrent la phrase ; pas de virgule automatique après et/mais en tête de ligne.
1) Addition (ajouter sans lourdeur)
- courant : de plus ; en outre ; par ailleurs ; aussi (en tête de phrase, suivi d’inversion : Aussi faut-il…) ; de surcroît (plutôt soutenu).
- exemples :
Le narrateur adopte la focalisation interne ; de plus, le lexique sensoriel renforce l’immersion.
Par ailleurs, la structure en miroir stabilise la lecture.
À éviter : empiler de plus trois fois ; alterner de plus / en outre / par ailleurs.
2) Opposition / contraste (poser un versus net)
- courant : mais ; en revanche ; au contraire ; à l’inverse.
- soutenu : toutefois ; néanmoins ; cependant ; pour autant.
- exemples :
Le passage multiplie les hyperboles ; en revanche, la chute est minimaliste.
Cependant, la scène conserve une logique réaliste.
Piège : pour autant exprime souvent une restriction après une concession : Il concède l’erreur ; pour autant, il refuse de s’excuser.
3) Concession (admettre… mais continuer)
- courant : certes… mais ; bien que ; quoique ; même si ; malgré + nom.
- soutenu : quand bien même + conditionnel ; nonobstant + nom.
- exemples :
Certes, l’argument est séduisant ; mais il demeure fragile.
Bien que bref, l’extrait est dense.
Différence : opposition = contredit ; concession = admet une part avant de restreindre.
4) Cause / explication (répondre à « pourquoi ? »)
- courant : car ; parce que ; puisque ; comme (en tête de phrase).
- soutenu : étant donné que ; dans la mesure où ; dès lors que.
- exemples :
La tension monte parce que les répliques se raccourcissent.
Comme l’incipit est descriptif, l’action démarre tard.
À ne pas confondre : car (justification logique en discours) ≠ parce que (cause réelle).
5) Conséquence / déduction (répondre à « donc ? »)
- courant : donc ; ainsi ; alors ; par conséquent.
- soutenu : dès lors ; partant ; il s’ensuit que ; de sorte que.
- exemples :
Les champs lexicaux convergent ; dès lors, la thèse s’impose.
La syntaxe saccadée, de sorte que le rythme devient haletant.
Piège : ainsi peut être exemplification (voir § 8) ou conséquence selon la place.
6) But / intention (visée)
- courant : pour ; afin de ; afin que + subj. ; de peur que + subj.
- soutenu : en vue de ; de manière à / de façon à.
- exemples :
Il répète afin de convaincre.
Les modalisateurs sont atténués de peur que la critique ne paraisse violente.
7) Condition / hypothèse
- courant : si ; à condition que + subj. ; à supposer que + subj.
- soutenu : pour peu que ; moyennant que ; quand bien même + cond.
- exemples :
Si l’on admet cette lecture, la métaphore devient structurante.
À condition que l’ironie soit perçue, la morale change.
8) Exemple / illustration
- courant : par exemple ; ainsi ; notamment ; en particulier.
- soutenu : entre autres ; à savoir.
- exemples :
Plusieurs indices signalent la satire : notamment l’hyperbole et l’ironie.
Ainsi, « la foule hurle » condense la violence.
9) Reformulation / équivalence
- courant : autrement dit ; en d’autres termes ; c’est-à-dire ; soit.
- soutenu : pour le dire autrement ; en somme (semi-concluant).
- exemple :
Le narrateur est peu fiable — autrement dit, sa voix est biaisée.
10) Restriction / réserve
- courant : mais ; toutefois ; du moins ; en partie ; à ceci près que.
- soutenu : sauf que (oral) → préférer si ce n’est que en copie ; hormis ; sauf à + inf.
- exemple :
L’argument tient, du moins dans la première moitié du roman.
11) Comparaison / analogie
- courant : comme ; de même ; à l’instar de.
- soutenu : de la même manière que ; mutatis mutandis (éviter en copie si non maîtrisé).
- exemple :
À l’instar de la fable, le conte délivre une morale implicite.
12) Chronologie / transition temporelle
- courant : d’abord ; ensuite ; puis ; enfin ; auparavant ; désormais.
- soutenu : tandis que (simultanéité) ; sitôt que.
- exemple :
- D’abord, le décor ; ensuite, le conflit ; enfin, la résolution.*
13) Insistance / emphase (avec parcimonie)
- courant : surtout ; précisément ; justement ; en effet (preuve), de fait.
- soutenu : à vrai dire ; à tout le moins ; bel et bien.
- exemple :
En effet, la reprise anaphorique confirme la thèse.
Piège : en effet répond à une affirmation précédente ; ne pas l’utiliser comme simple « par exemple ».
14) Bilan / conclusion / ouverture
- courant : en somme ; en définitive ; au final (à éviter en copie) ; finalement ; pour conclure.
- soutenu : en définitive ; en dernière analyse ; somme toute ; au demeurant (≠ conclusion stricte).
- exemples :
En somme, le texte met en cause l’idéalisme.
On peut en conclure que la scène est satirique.
15) Couples à ne pas confondre (mini-dico)
- toutefois / pourtant / cependant : synonymes proches ; varier selon le rythme.
- or : charnière logique qui introduit un fait nouveau → mène souvent à donc.
- ainsi : au début de phrase = conséquence (Ainsi, nous concluons…) ; au milieu = exemple (… ; ainsi, « X »…).
- de fait / en fait : de fait = constat, résultat ; en fait = rectification (registre oral → éviter en copie).
- car / parce que : car = justification discursive ; parce que = cause objective.
16) Dosage et placement (règles simples)
- Un connecteur = une relation précise. Évite la rafale : Cependant, néanmoins, toutefois → choisis un.
- Place démarquée : en tête de phrase ou après le verbe — selon la respiration.
- Varie les familles : alternes opposition / cause / conséquence, pas seulement addition.
- Vérifie la vérité logique : ne mets pas donc si la conséquence n’est pas démontrée.
- Révision : supprime tout connecteur qui n’ajoute rien ; réécris la phrase si le connecteur masque un lien flou.
17) Mini-briques prêtes à copier (procédé → effet → sens)
- Concession : Bien que la scène paraisse comique, elle soutient toutefois une critique sociale.
- Opposition nette : Le décor est bucolique ; en revanche, la syntaxe heurtée crée l’angoisse.
- Cause → conséquence : Le rythme saccadé parce que les phrases se brisent ; dès lors, la tension augmente.
- Exemple : L’hostilité est manifeste ; ainsi, « on le chasse ».
- Reformulation-bilan : Ces indices convergent ; autrement dit, le narrateur n’est pas fiable.