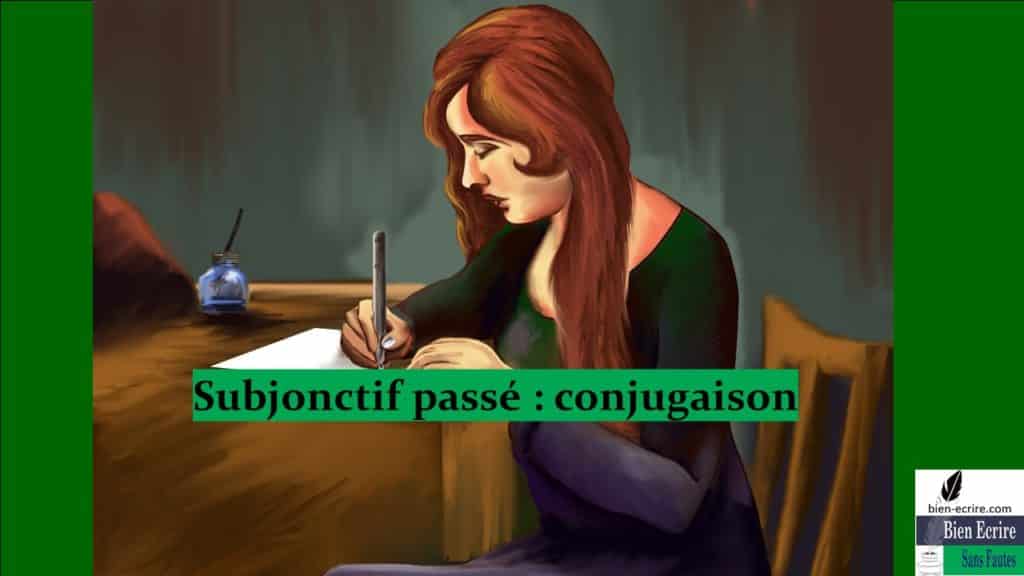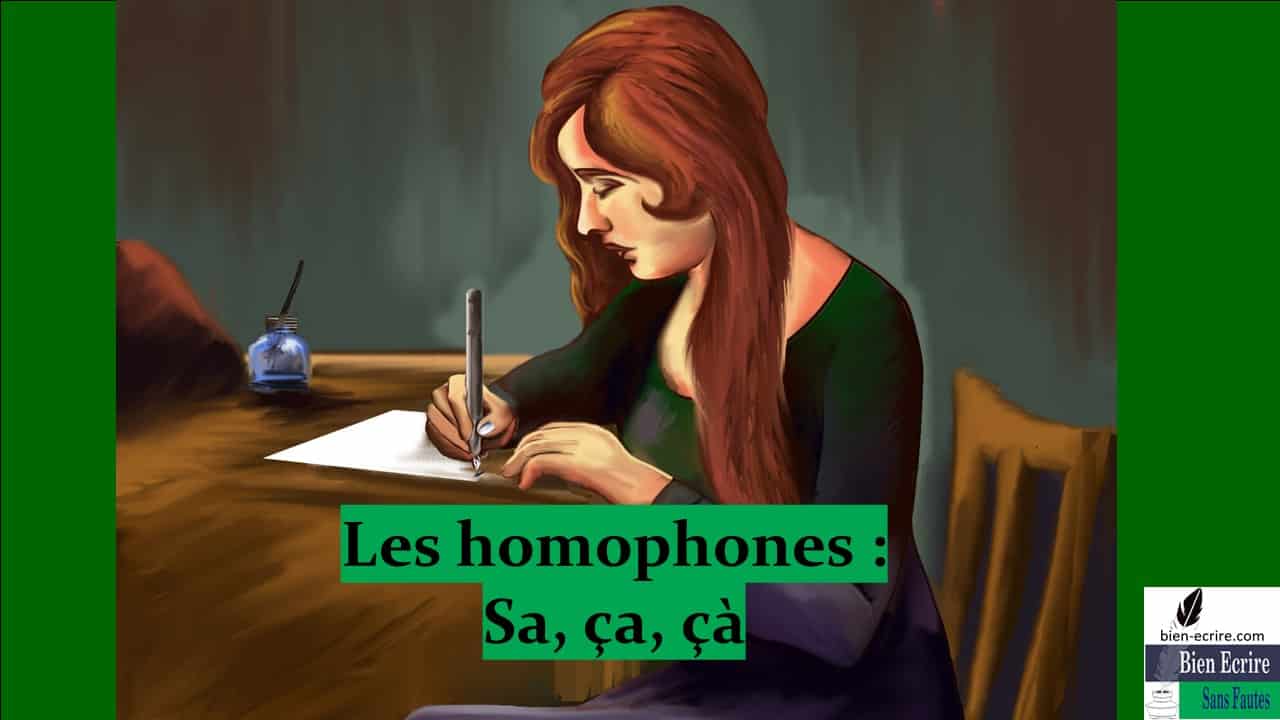Objectif
Vous saurez distinguer l’apposition (groupe nominal ajouté au voisinage d’un nom) de l’incise (proposition courte insérée, souvent avec un verbe de parole), choisir la ponctuation adaptée (virgules, tirets, parenthèses) et éviter les ambiguïtés à l’écrit.
L’essentiel à retenir
- Apposition = ajout nominal collé à un nom pour le préciser ou le renommer. Elle se détache aux virgules, parfois aux tirets ou parenthèses.
Ex. : Camille, notre coordinatrice, finalise le dossier. - Incise = proposition courte, souvent avec un verbe de parole ou de pensée (dire, répondre, ajouter, penser), qui rapporte ou commente l’énonciation.
Ex. : « J’arrive », dit-elle, « gardez-moi une place ». - Astuce décisionnelle : s’il y a un verbe conjugué qui attribue une parole ou un point de vue, vous êtes dans l’incise ; s’il s’agit d’un groupe nominal qui renomme ou précise un nom, c’est une apposition.
1) Apposition : définir, choisir la ponctuation, doser l’effet
1.1 Définition
- Segment nominal (GN) juxtaposé au nom noyau pour préciser, renommer, qualifier.
Ex. : Victor Hugo, poète et romancier, publie Les Contemplations.
1.2 Deux valeurs fréquentes
- Renommage (apposition explicative) : le second GN désigne à nouveau le même référent.
Ex. : La Seine, fleuve majeur, traverse Paris. - Précision (apposition descriptive) : le second GN ajoute un trait.
Ex. : Emma, experte conformité, prendra la parole.
1.3 Ponctuation de l’apposition
- Virgules : choix standard, ton neutre.
L’auteur, ancien lauréat, revient en librairie. - Tirets : mise en relief plus marquée, effet d’incise visuelle.
L’auteur – ancien lauréat – revient en librairie. - Parenthèses : aparté discret, périphérique au propos.
L’auteur (ancien lauréat) revient en librairie.
Bon réflexe : si la phrase reste grammaticale sans le segment détaché et que le sens noyau subsiste, vous avez bien une apposition.
2) Incise : rapporter, commenter, rythmer
2.1 Définition
- Proposition brève intercalée qui attribue une parole, un sentiment, un point de vue, ou oriente la lecture. Verbe fréquentatif : dire, répondre, demander, ajouter, préciser, penser, estimer, croire.
Ex. : « Nous validons », précise la présidente, « dès cet après-midi ».
2.2 Position et accents typographiques
- En position médiane : la plus fréquente. Encadrez de virgules.
« Je passe », dit-il, « dans dix minutes ». - En tête : virgule après l’incise.
Dit-il, « je passe dans dix minutes ». - En fin : virgule avant l’incise, point après.
« Je passe dans dix minutes », dit-il.
2.3 Accord, majuscules et signes
- Dans un dialogue au style direct, la majuscule porte sur la réplique, pas sur l’incise si elle suit un point-virgule, une virgule ou un tiret de dialogue.
- Les guillemets français « … » et les espaces fines insécables avant ; : ? ! sont recommandés.
- L’incise peut adopter l’ordre inversé (dit-elle) ou droit (elle dit), au choix du ton.
Repère sûr : si l’élément inséré contient un verbe conjugué et attribue l’énoncé, c’est une incise, pas une apposition.
3) Apposition vs incise : la grille « 3 questions »
- Nature grammaticale : GN isolé → apposition ; proposition avec verbe → incise.
- Fonction : renommer/préciser un nom → apposition ; attribuer/ commenter une parole → incise.
- Ponctuation : l’une et l’autre se détachent, mais l’incise s’insère dans la mécanique du discours rapporté.
4) Cas proches et pièges à éviter
- Relative explicative vs apposition
- Relative : Le projet, qui est prioritaire, avance. (proposition avec verbe)
- Apposition : Le projet, priorité absolue, avance. (segment nominal, sans verbe)
- Épithète détachée vs apposition
- Épithète détachée = adjectif séparé par virgule : L’équipe, prête, entre en scène.
- Apposition = GN : L’équipe, favorite, entre en scène. (adjectif substantivé possible, mais sentez le GN implicite : « l’équipe, la favorite »)
- Surgonflage typographique
- Évitez d’additionner virgules + tirets + parenthèses pour un même segment. Choisissez un seul procédé.
- Ambiguïté de portée
- Placez l’apposition au plus près du nom qu’elle précise. Évitez : Le directeur a annoncé, hier, la réouverture si hier ne porte que sur annoncé.
5) Choisir entre virgules, tirets, parenthèses
- Virgules : la norme « passe-partout » pour une info intégrée.
- Tirets : relief, pause plus sonore, info saillante.
- Parenthèses : aparté secondaire, info optionnelle au fil du texte.
Ligne éditoriale : sur support scolaire ou administratif, privilégiez la virgule pour l’apposition et la virgule pour les incises de parole. Réservez les tirets à la mise en relief voulue.
6) Rappels typographiques utiles
- En français, on insère une espace insécable avant ; : ? ! et à l’intérieur des guillemets « … ».
- Pour les dialogues, les tirets de parole sont suivis d’une espace :
– « J’arrive », dit-elle. – « Parfait », répond-il.
Mini-FAQ
Une apposition peut-elle être obligatoire pour le sens ?
Non. Par définition, on peut retirer l’apposition sans perdre l’identification minimale du nom noyau. On perd une précision, pas le référent.
Peut-on écrire l’incise sans inversion du sujet ?
Oui. « Je confirme », elle dit. reste possible, mais « Je confirme », dit-elle. est plus typique et plus léger.
Les tirets conviennent-ils aux incises de parole ?
On les emploie plutôt pour des incidentes longues ou pour rythmer. Pour la parole rapportée, la virgule est préférable.
Apposition ou relative explicative, cela change-t-il le sens ?
Parfois. L’apposition renomme de façon statique ; la relative énonce un fait. Choisissez selon la visée : portrait fixe (apposition) ou information verbale (relative).
Faut-il des majuscules dans l’incise ?
Non, sauf si l’incise commence la phrase. La majuscule se réserve à la réplique entre guillemets ou après point.